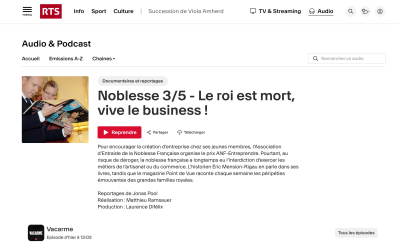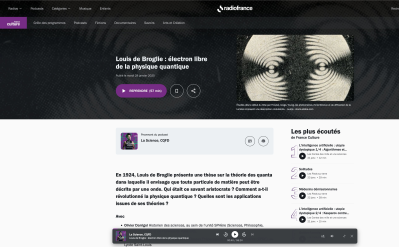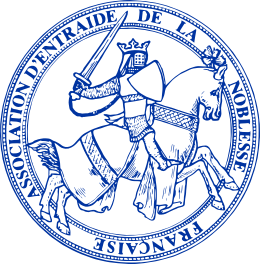News

Le Figaro : "La surprenante soirée «Louis XVI» du Figaro Histoire"
RÉCIT - Le 21 janvier dernier, Le Figaro Histoire organisait à guichets fermés au cinéma L’Arlequin une soirée autour du film Le Déluge, avec Guillaume Canet et Mélanie Laurent, sur la vie de la famille royale au Temple. Rien ne se passa comme prévu.

Table ronde sur le procès de Louis XVI avec Charles-Éloi Vial et les avocats Philippe Goossens et Carbon de Seze, animée par Isabelle Schmitz. Le Figaro Histoire
Les lecteurs avaient prévu une soirée somme toute classique. Le Figaro Histoire les avait invités au cinéma L’Arlequin à Paris, pour la projection du Déluge, film de Gianluca Jodice, qui ressuscite la vie de la famille royale au Temple dans l’attente du procès de Louis XVI et jusqu’à son exécution. Il y aurait eu ensuite des tables rondes d’historiens faisant quelques reproches çà et là, tatillons sur le respect des décors, des vêtements. On en aurait surtout appris sur la grandeur d’un roi incompris. Il y aurait eu un buffet enfin, et peut-être quelques royalistes un peu fashionables en cravate noire pour marquer ce 21 janvier. Tout cela devait être très agréable. Que nenni ! Ce fut bien plus : comique, tragique, passionnant, révoltant, à cause d’un film qui divisa profondément l’audience et grâce à un programme passionnant consacré au souverain au jour anniversaire de sa mort.
Pour ce fameux Déluge, production italienne, nous vous laissons le soin de vous faire votre avis. Le Figaro en a officiellement plusieurs. Celui du critique maison Éric Neuhoff, qui pourfend un film sans relief. Celui du rédacteur en chef du Figaro Histoire Geoffroy Caillet, qui salue sa subtilité. Celui du directeur adjoint du Figaro Magazine Jean-Christophe Buisson, qui applaudit sa hauteur, le qualifiant de «pari risqué... brillamment réussi».
Mais ce soir-là, après la projection du film sur le procès, ce fut le procès du film. Le Déluge ? Un naufrage, clamèrent en substance les grands spécialistes de la période. Pour Emmanuel de Waresquiel, auteur de plusieurs ouvrages sur la Révolution et notamment Il nous fallait des mythes, la Révolution et ses imaginaires de 1789 à nos jours (Tallandier), Louis XVI était très loin du personnage volontairement falot projeté à l’écran quelques instants plus tôt. « Le roi était tout autre, jaloux de son pouvoir, colérique y compris au Temple », soulignait-il. Un roi vu comme un grand enfant, dans un rôle « aussi inconsistant que le film lui-même », flinguait l’historien, sans se départir de son flegme. Avant de répondre aux récriminations d’une spectatrice : « Vous avez eu des émotions, vous ? Bravo ! ».
Charles-Éloi Vial, biographe de Marie-Antoinette et auteur d’un livre très documenté sur La Famille royale au Temple (Perrin) donnait à son tour quelques précisions, notamment sur la représentation du Temple, « un lieu grouillant de vie, en pleine ville à tel point que le roi et la reine tentaient de rester informés en écoutant les colporteurs de rue », et non un château de campagne perdu au bout d’une longue allée. Avant de donner son avis de spectateur, « un peu moins sévère qu’Emmanuel de Waresquiel : le film est assez long et ennuyeux ». Protestations de la salle.
Bon. La reine, ensuite. Waresquiel : « Le metteur en scène reprend la littérature pamphlétaire qui fait d’elle une Messaline qui n’hésite pas à coucher avec quiconque en fonction de ses désirs ou de ses intérêts. La seule chose qui colle, c’est l’amour qu’elle porte à ses enfants ». Il y avait du mieux ! Vial : « J’ai trouvé Marie-Antoinette très égoïste dans tout le film, ne s’occupant pas de ses enfants, se préoccupant essentiellement de son sort ». Patatras. Plus tard, les spectateurs hésiteraient. Oui, Guillaume Canet joue un roi égaré, mais l’image n’a-t-elle pas, justement, un certain intérêt artistique ? Oui, Mélanie Laurent en Marie-Antoinette alterne entre la diva capricieuse et le tyran domestique. Mais l’interprétation possède une certaine force, et n’est-il pas salutaire de sortir enfin de l’image coppolesque d’une souveraine ingénue, qu’on nous serine à chaque nouvelle sortie audiovisuelle ?
Le lendemain matin, Michel De Jaeghere, directeur de la rédaction du Figaro Histoire et Geoffroy Caillet, rédacteur en chef, quoique enchantés par la soirée, formulaient des contre-arguments en plein open space. S’échinaient à défendre le film, qui faisait un portrait du souverain certes étrange, mais duquel il sortait selon eux grandi, par sa résolution, par sa sérénité. Et de citer une réplique de Guillaume Canet, suffisante pour lui rendre sa couronne : « Je vois tout et je comprends tout ». Le Louis XVI du Déluge, benêt mutique ou vrai chrétien habité par son martyre à venir? Père protecteur ou monarque enfantin ? Recul superbe pour les uns, défaitisme pour d’autres. On pense à Ridicule, de Patrice Leconte : « On dit d’un homme d’esprit qui se tait qu’il n’en pense pas moins. Mais un sot qui se tait n’en pense pas davantage ». À cette heure les débats se poursuivent dans les bureaux du Figaro...
Plaidoiries
Revenons à la soirée : après cette première table ronde, la rédaction avait invité deux avocats à rejouer librement le procès de Louis XVI. Les gausseries s’éteignirent bien vite. Maître Philippe Goossens fut un Robespierre tranchant, la voix sinusoïdale, roulant des railleries de caniveau aux cimes de la haine. Oh ! Il assurait détester la peine de mort, mais faisait de celle de «Louis Capet» la condition de la pérennité de la République. Tant que la tête du roi n’était pas coupée, la France ne pouvait entrer dans une nouvelle ère. Tout l’esprit du temps révolutionnaire suinta de ce texte hargneux et confiant, tellement confiant. Avec cette hypocrisie doucereuse qui ferait florès jusqu’aux totalitarismes. À ces mots rouges, Maître Carbon de Seze opposa ceux de son propre oncle Raymond de Seze, défenseur du roi avec Malesherbes et Tronchet. Calme, d’un ton à la fois triste et combatif, il opposa le passé aux promesses d’avenir radieux. Les siècles qui avaient lentement permis de définir ce qu’est un procès équitable et auquel le roi déchu n’avait même pas droit. Les hommes nouveaux dont accouchait cette révolution semblaient d’un coup bien gothiques, escomptant commencer dans la cruauté une ère de paix, choisissant d’ignorer le double corps du roi. La Convention de 1793 avait-elle été gênée par cette cruelle ironie? La salle de 2025, qui connaissait la suite, se scandalisait en silence.
Autour d’Isabelle Schmitz, directrice adjointe de la rédaction, Charles-Éloi Vial et les avocats tirèrent un rapide bilan de cette joute. Le véritable acte de naissance de la démocratie représentative en France fut bien un procès politique. Cela lui était nécessaire : « La République se mettait en danger si elle lançait un appel au peuple », rappela Carbon de Seze. On se fit quelques réflexions intérieures sur l’ADN de ce régime, mais le temps filait. À peine le temps de rendre hommage au magnifique Malesherbes, « plus grand avocat de l’histoire », selon Philippe Goossens, et qui périt peu après son client et de la même manière.

Plaidoiries de Mes Philippe Gossens et Carbon de Seze Le Figaro Histoire
Après un extrait du Requiem de Mozart, le comédien Simon Volodine monta enfin sur l’estrade pour lire le testament de Louis XVI, écrit un mois avant son exécution. L’apparence et l’interprétation collaient parfaitement à l’image populaire, au souvenir qu’a laissé cet homme et qui s’est perpétué, au-delà des travaux des historiens, en chacun des Français. Quand il s’autorise à être grave, un homme débonnaire touche au cœur. « N’ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m’adresser, je déclare ici en sa présence mes dernières volontés et mes sentiments »… La piété de Louis XVI, quelque peu inaccessible et comme en façade dans le film, se montrait ici toute entière. « Je recommande à mon fils, s’il avait le malheur de devenir roi, de songer qu’il se doit tout entier au bonheur de ses concitoyens ». Le malheur de devenir roi : quel poids dans cette expression ! Quant au malheur d’être sans roi... Isabelle Schmitz conclut la soirée en livrant à la réflexion de chacun ce propos d’Ernst Jünger : « J’ai l’impression que toute la misère de nos jours a commencé par l’exécution de Louis XVI. » Il y eut bien un buffet pour finir. On ne se souvient pas d’y avoir noté de cravate noire, mais on aurait compris que certains la portent.