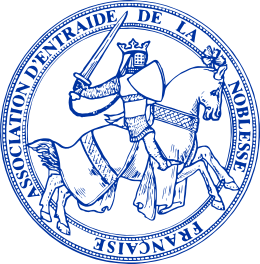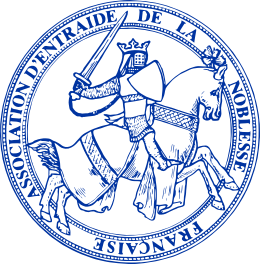News
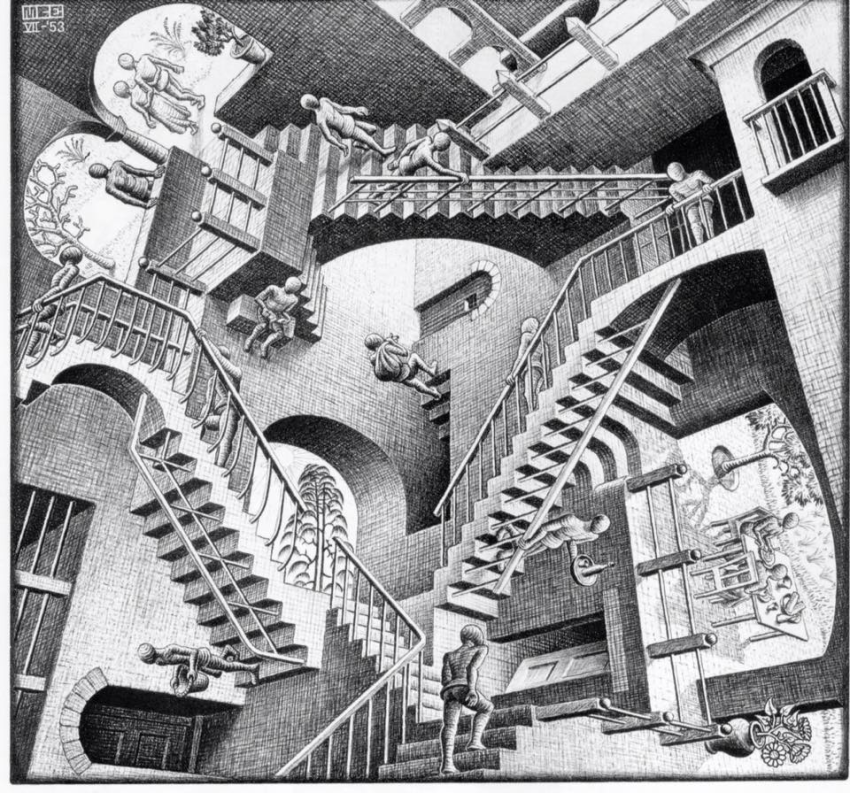
L’innovation, une vieille histoire
Par Olivier Adam, IEP Paris, maître en philosophie et en science politique, ancien directeur d’entreprise (autoroutes, aéronautique), conseil en transformation et leadership, auteur de « La Soft-idéologie » (Robert Laffont) sous le pseudonyme de Pierre Barbès en collaboration avec François-Bernard Huyghe.
« Le Soleil, nouveau chaque jour » (Héraclite)
Comment la notion contemporaine d’innovation peut-elle s’inscrire de façon cohérente avec celle de culture ? Quelques repères historiques pour mieux comprendre d’où vient cette notion que tout le monde emploie, mais dont personne ne connaît vraiment l’histoire.

L’innovation est aujourd’hui couramment invoquée à divers titres dans les discours (politiques, scientifiques, économiques, sociologiques, entrepreneuriaux) comme la dynamique collective fondamentale, sans laquelle aucun avenir ne saurait s’envisager. Le terme semble remplacer avantageusement celui de progrès, formalisé au XVIIIème siècle par Nicolas de Condorcet dans son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795), employé de façon assez systématique aux XIXème et XXème siècles comme justification politique et sociale, et mis à mal depuis quelques années du fait de la perception répandue assez largement dans l’opinion du déclin économique. Comme beaucoup de mots clefs d’une époque, le terme d’innovation utilisé aussi fréquemment que de façon disparate reste un concept flou, qu’on évite en général de définir pour pouvoir l’utiliser d’autant plus facilement. Raison de plus pour analyser ce qu’il recouvre ainsi que l’ambition d’en faire la base des organisations économiques voire de la société, à travers la notion de sa généralisation dans une culture d’innovation.
Le terme ‘innovation’ n’a pas, à notre connaissance, fait l’objet d’une histoire. Pourtant, l’usage du mot est attesté en France et en Angleterre dès 1297 selon l’Oxford English Dictionary. Il est dérivé du latin qui utilise le verbe ‘innovo’ (j’introduis la nouveauté à l’intérieur) et le nom ‘novatio’, dans un sens de renouvellement et de mise à jour (d’une loi par exemple). A l’ère chrétienne, il est adopté par les théologiens pour rendre compte de l’action du Christ, qui renouvelle l’ancienne Alliance en lui redonnant tout son sens et en l’accomplissant. Saint Jérôme de Stridon emploie le terme à nombreuses reprises dans sa traduction de la Bible en latin (405), la Vulgate, version de référence de la Chrétienté, et dont la diffusion urbi et orbi sera immense en Europe, en devenant le premier livre imprimé de l’histoire grâce à Johannes Gutenberg (1454). Par exemple : « Innova signa et inmuta mirabilia » (Eccles, 36,6). Le grand Innovator, c’est le Christ ressuscité, qui apporte à l’humanité le renouveau du salut.
Au début de la crise majeure de la Chrétienté qui aboutira au XVIème siècle à la scission de l’Eglise, Martin Luther réclame dans ce sens « die Erneuerung » (l’innovation, le renouveau) de la vrai Foi. « Die Reformation » se définit comme l’aboutissement de cette Erneuerung. Les Catholiques vitupèrent alors contre l’innovation, dont la signification, de positive qu’elle était, devient pour eux négative. Avec les guerres de religion, l’usage du mot au singulier passe alors au pluriel (« les innovations »). Les deux camps, catholique et réformé, vont, en utilisant ce terme, s’accuser réciproquement de vouloir transformer la religion, d’en inventer des variantes nouvelles, bref de vouloir innover à tort et à travers. Les Catholiques accusent les partisans de la Réforme d’être des innovateurs en voulant détruire la transmission de la foi par leurs nouveautés hérétiques. Les Protestants dénoncent en retour la Papauté comme innovatrice pour avoir introduit petit à petit des innovations inacceptables parce qu’idolâtres dans le culte et les institutions chrétiennes, ce pourquoi ils entendent revenir à la vraie religion originelle. L’innovation dont chacun incrimine l’autre est jugée comme l’aberration de la déviance au service d’un faux renouveau, réprouvé des deux côtés, et qu’il faut corriger soit par la Réforme - soit par la Contre-Réforme, selon le point de vue adopté.
Plus tard, du côté anglican, quand on prendra peur d’un retour vers le Catholicisme désiré par une partie de l’opinion, l’innovation sera alors perçue comme la volonté de saper le pouvoir royal en modifiant ses prescriptions. En 1548, Edouard VI, le fils de l’auteur de la rupture anglicane Henri VIII, promulgue une Proclamation against those that doeth innovate. Il stipule “No maner persone, of what estate order or degree soever he be, will or phantasie, do omitte, change, alter or innovate any order, rite or ceremony commonly used and frequented in the Church of England.” L’innovation est alors présentée comme la déstabilisation d’un acquis décidé par l’autorité légitime, qu’il faut défendre coûte que coûte contre les novateurs. C’est à ce moment que l’innovation prend la signification de ce qui affaiblit (dans le domaine religieux) le pouvoir en place.
Parallèlement, comme la controverse entre catholiques et protestants se poursuit en France partagée entre les deux cultes dans la période qui suit l’Edit de Nantes jusqu’à sa révocation, elle renforce ces Leitmotiv. Ainsi Jacques-Bénigne Bossuet, qui discute avec le philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz dans les années 1670 d’une réunification (qui n’aboutira pas…) entre les deux confessions (Opuscules) : « Pour ces changements insensibles qu’on nous accuse d’avoir introduit dans la doctrine, (…) on ne peut nous montrer d’innovation par aucun fait positif (…). Mais en quelque partie du monde où il y ait eu une interruption de la doctrine ancienne, la date de l’innovation et de la séparation n’est ignorée de personne. » L’innovation se voit ajouter alors la nuance de changement radical et d’altération de contenus dont la légitimité repose sur l’ancienneté. Le conflit se déplace entre l’innovation et l’ancienneté.
La période qui suit la révolution anglaise d’Oliver Cromwell à la fin du XVIIème siècle sera peu après la cause d’une inflexion majeure de la signification de l’innovation, par l’importation décisive du mot en dehors du lexique religieux dans la sphère politique. Lors de la restauration monarchique qui lui a succédé, en effet, les publicistes britanniques hostiles aux républicains vaincus, les accusent d’avoir été des « innovators » en ayant voulu imposer par force un régime révolutionnaire modifiant les usages et les mœurs de la plupart des habitants pour mieux conforter leur domination. L’innovation apparaît comme pernicieuse, car toute modification même mineure peut contribuer à démanteler l’ensemble de l’organisation. « All innovations are dangerous. It is like a watch which any one piece lost will desorder the whole », selon un libelle de 1681.
C’est ce sens politique que les hommes des Lumières vont relever en lui ôtant sa connotation péjorative. Ils ont besoin de désigner le mouvement de réforme rationnelle auquel ils veulent soumettre l’organisation politique et sociale traditionnelle, et empruntent le terme en lui conférant cette fois un sens positif. L’Encyclopédie (1774) définit ainsi l’innovation : « nouveauté, ou changement important qu’on fait dans le gouvernement d’un état, contre l’usage et les règles de sa constitution… Les révolutions que le temps amène dans le cours de la nature, arrivent pas-à-pas ; il faut donc imiter cette lenteur pour les innovations utiles qu'on peut introduire dans l'état. » Néanmoins, le terme de révolution comme on le voit lui fait concurrence, et on sait qu’il l’emportera finalement, du fait de sa connotation plus globale et moins analytique. On a vu également plus haut que le terme de progrès a occupé une place centrale de ce moment jusqu’à nos jours pour désigner ce qui est nouveau.
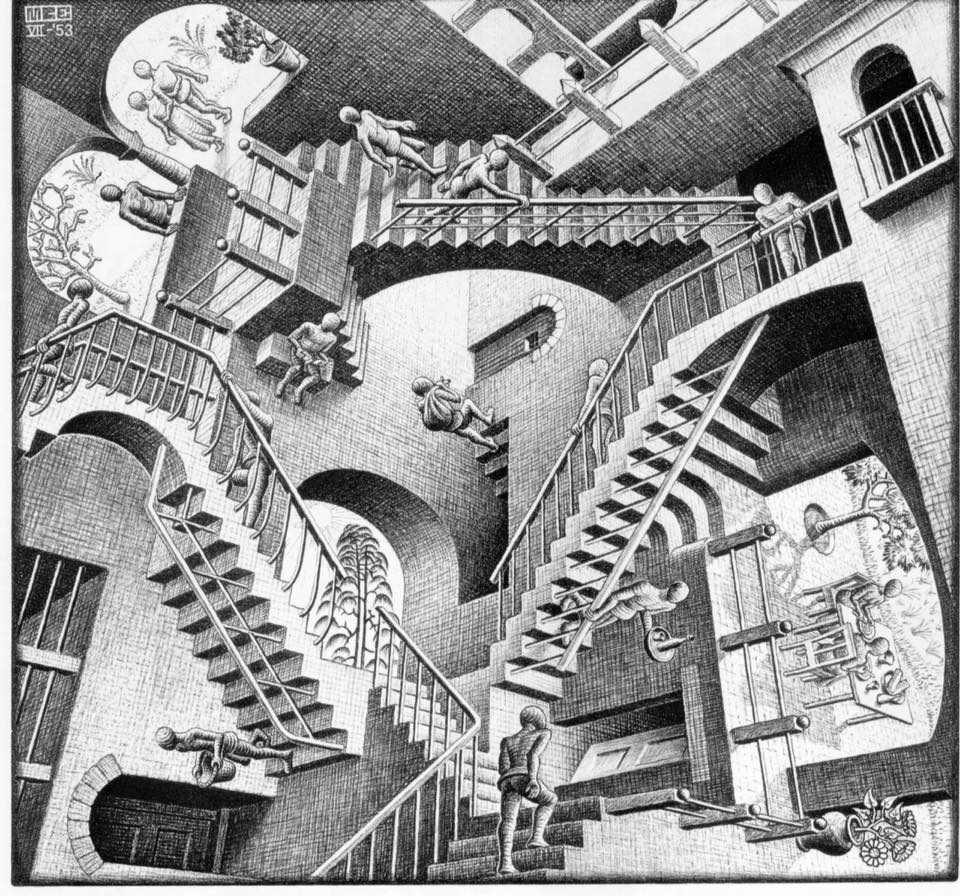
La réintroduction du terme ‘innovation’ et sa généralisation, sur laquelle nous vivons encore aujourd’hui, est opérée par le philosophe Auguste Comte. Sous l’influence de son maître, l’économiste Claude-Henri de Saint-Simon, il entreprend une synthèse entre les idées rationalistes des Lumières (notamment Jean d’Alembert, Nicolas de Condorcet) et la critique contre- révolutionnaire empiriste (Joseph de Maistre, Louis de Bonald) au profit d’une philosophie positive, qui se veut éloignée des abstractions comme des superstitions, et conforme à l’expérience selon l’esprit scientifique. Il va, dans ce cadre, transformer en concept anthropologique le terme d’innovation, en l’introduisant dans le vocabulaire de la science nouvelle qu’il fonde, la sociologie. Il discerne dans l’évolution de la société, la « lutte fondamentale de deux esprits », complémentaires mais en concurrence, « l’esprit d’amélioration ou d’innovation » et « l’esprit de conservation » (Cours de philosophie positive (1830-1842). Si l’esprit de conservation est mu par les « instincts personnels », l’esprit d’innovation est « la combinaison de l’activité intellectuelle avec les instincts sociaux », développée par « la civilisation ».
Cette vision de la dynamique de toute société, de toute civilisation et de toute culture à la fois comme antagonisme et comme complémentarité, caractérise toutes les conceptions du monde moderne, édifiées sur le couple de notions : ordre et progrès, ordre établi et mouvement, conservation et réforme (voire révolution). Curieusement, elle ne sera pas reprise sur le terrain scientifique par l’école sociologique universitaire française, instituée par Léon Durkheim qui privilégie la dynamique unidimensionnelle de progrès. Ce sera Gabriel de Tarde, qui, s’opposant à Durkheim, bâtira une alternative qu’il dénommera la psychologie sociale, féconde surtout à l’étranger (aux Etats Unis par exemple), appuyée sur la théorie d’une logique structurelle constituée par l’interaction de deux types de lois fondamentales dans toute organisation collective, les « lois de l’invention », et les « lois de l’imitation », dont la combinaison produit l’innovation (Logique sociale, 1895). L’innovation en fait est le fruit de l’ajustement des processus d’invention et d’imitation. Sans la mise en mouvement de l’imitation, l’invention ne peut aboutir au changement pratique qui caractérise l’innovation. La conception de Tarde est de ce point de vue la seule qui sait rendre compte de cette façon satisfaisante de l’innovation comme application fructueuse et reproductible d’inventions (scientifiques, techniques, sociales…) apportant à des groupes sociaux des améliorations tangibles, qui se substituent aux usages qui précèdent celles-ci. C’est ce que reconnaît par exemple le sociologue britannique contemporain Tony Bennett (Innovation and social Change) : « Depuis Gabriel Tarde, il n’y a plus aucune tentative réelle visant à formuler une explication théorique du processus d’innovation et des circonstances sociales et individuelles qu’il implique. »
Il appartenait à l’économiste autrichien Joseph Schumpeter de compléter la définition sociologique de Tarde dans un modèle économique. Elève et disciple du fondateur de l’Ecole autrichienne Friedrich von Wieser (de même que le penseur de l’anti-constructivisme Friedrich von Hayek), ainsi que des sociologues allemands Werner Sombart et Max Weber, Schumpeter, en étudiant les cycles économiques, découvre le rôle de l’innovation dans le développement de l’économie et le passage d’une étape à une autre comme d’une révolution technologique à l’autre. Il décèle des « grappes d’innovations » qui, en se combinant les unes aux autres, produisent des effets de seuil et modifient radicalement l’environnement économique et social, comme on le constate de la révolution néolithique jusqu’à nos jours. Plus particulièrement, il théorise la recherche systématique de l’innovation, qui accélère et généralise de nos jours la transformation du monde avec l’expansion du capitalisme : « L'impulsion fondamentale qui met et maintient en mouvement la machine capitaliste est imprimée par les nouveaux objets de consommation, les nouvelles méthodes de production et de transport, les nouveaux marchés, les nouveaux types d'organisation industrielle – tous éléments créés par l'initiative capitaliste. L'histoire de l'équipement productif d'énergie ne diffère pas, depuis la roue hydraulique jusqu'à la turbine moderne, ou l'histoire des transports, depuis la diligence jusqu'à l'avion. L'ouverture de nouveaux marchés nationaux ou extérieurs et le développement des outils de production, depuis l'atelier artisanal et la manufacture jusqu'aux grandes fusions telles que l’US Steel, constituent d'autres exemples du même processus de mutation industrielle qui révolutionne incessamment de l'intérieur la structure économique, en détruisant continuellement ses éléments vieillis et en créant continuellement des éléments neufs. Ce processus de destruction créatrice constitue la donnée fondamentale du capitalisme : c'est en elle que consiste, en dernière analyse, le capitalisme et toute entreprise capitaliste doit, bon gré mal gré, s'y adapter. » (Capitalisme, Socialisme et Démocratie, 1942).

La notion d’innovation est ainsi positionnée, telle que nous l’employons aujourd’hui : elle repose sur un mouvement intellectuel et créatif de remise en cause de l’existant et de l’admis, consiste dans l’application d’invention(s) à des usages collectifs, débouchant sur l’organisation reproductible, viable et rentable de production d’offres et de demande des marchés, et elle se substitue aux anciens usages qu’elle rend caducs en les éliminant. De part en part intellectuelle, technologique, sociologique, économique, elle devient le moteur de la croissance des revenus correspondant à la croissance démographique.
Depuis Tarde et Schumpeter, aucune théorie ne semble avoir vraiment modifié le concept d’innovation. L’économiste américain contemporain Robert Solow à la suite des études de Schumpeter a mis au point un modèle, qui est en fait un paradoxe : du fait du rendement décroissant des facteurs de production, toute augmentation de ces facteurs ne permet pas la croissance de la production par tête. L’économie devrait être théoriquement stationnaire. En pratique, les innovations incessantes accroissent la productivité des facteurs, d’où la croissance économique. Mais l’innovation ne peut entrer dans le modèle mathématique, et la croissance est donc imprévisible. Ses continuateurs Paul Romer, Robert Lucas, et Robert Barro ont tenté de résoudre le paradoxe en essayant de valoriser le paramètre explicatif : le niveau d’éducation, l’état des infrastructures, la recherche technologique selon les auteurs. L’un des fondateurs de l’Ecole de Chicago avec Milton Friedman, Yale Brozen, qui a renouvelé l’approche micro-économique, reprend la vision de Tarde : l’innovation provient de l’invention autant que de l’imitation. L’Autrichien Peter Drücker, qui tente de constituer une science du management, développe l’idée schumpétérienne selon laquelle la croissance d’une entreprise repose essentiellement sur la recherche de l’innovation systématique, que les dirigeants doivent étalonner par l’exploitation intensive des data du marketing. L’inflexion de sens de ces études tend en fait à renforcer l’équation courante aujourd’hui entre innovation, technologie et créativité à tel point que les termes tendent à devenir synonymes.
Le succès de l’extension indéfinie de l’application du terme d’innovation à tous les domaines qui s’en suit a fait naître depuis peu un débat chez les experts en consulting sur la question de savoir si la nature de l’innovation est technologique, à propos de laquelle s’opposent les « technologues » et les « créativistes ». Les premiers insistent sur le critère de saut qualitatif lié aux innovations fondamentales, permises par les changements de technologies, qualifiées d’« innovations de rupture » ; les seconds mettent en valeur toutes les « innovations insensibles » (de Bossuet) – qu’ils nomment « incrémentales » - capables par gradations de transformations sociétales, qui ne sont pas dues seulement à des changements technologiques mais également à des approches nouvelles (comme on le voit dans les services ou l’administration par exemple).
C’est avec ce background, largement redevable des analyses de Tarde et Schumpeter et de leurs prédécesseurs, que le concept d’innovation est employé aujourd’hui de manière inflationniste et de façon insuffisamment critique. On voit bien que le discrédit dans lequel est tombée la notion de progrès favorise l’essor de celle d’innovation, entendue comme un progrès plus modeste et plus ponctuel, qui n’apparaît plus forcément porteur d’avancées technologiques, sociales et civilisationnelles. Mais la tendance moderne d’exploitation du terme innovation, va jusqu’à verser dans la « neomania », qui consiste à survaloriser par principe tout ce qui est nouveau par rapport à ce qui le précède, à la manière de la mode.
Du côté industriel, les entreprises accélèrent le rythme de leur chaîne de production et améliorent l’attractivité compétitive de leurs produits, par le recours intensif à la numérisation dans tous leurs secteurs. Leurs dirigeants cherchent à diffuser l’élan d’une ardente culture d’innovation chez leurs salariés, reposant sur la créativité, la remise en cause des habitudes, la valorisation du nouveau au détriment de l’ancien. Ce faisant, ils oublient que leur organisation du travail et en particulier leur culture repose sur l’acquisition et la maîtrise de normes, standardisations, bref de règles donnant naissance à des process contraignants qui garantissent la qualité, la sécurité, l’uniformité des produits, process qu’ils s’essayent actuellement à digitaliser entièrement. Il est encore trop tôt pour faire le bilan des résultats de l’injonction paradoxale qui est faite ainsi aux salariés. Ce que nous savons, c’est que la confusion entre processus d’invention et d’innovation est erronée.
Dans la sphère publique, les classes politiques entreprennent dans nombre de pays de récupérer auprès de leurs électeurs le discours inspirant des entrepreneurs auprès de leurs salariés, au-delà de l’évocation de politiques nationales favorisant l’innovation, en fondant sur l’innovation un modèle euphorique de civilisation moderne, tourné vers le futur et se détournant du passé jugé « archaïque », ce qui aboutit en fait à une métamorphose de « l’avenir radieux » promis sans succès par les révolutions communistes.
Pourtant, l’innovation pourrait-elle devenir sans examen préalable la valeur fondatrice d’une société, d’une civilisation, d’une culture ? De nombreuse questions se posent à la lumière de notre cheminement. Si elle intervient par vagues successives, destructrices les unes des autres, peut-elle néanmoins laisser se former par accumulation la continuité du sens d’une histoire collective effacée par le halètement du court terme ? Le passé n’est-il qu’un cimetière d’obsolescences ? A-t-il vocation à être entièrement « déconstruit » ? Ne dégage-t-il pas, sous forme de « traditions » filtrées par le présent, une expérience, une évolution, une culture aussi inscrite dans le présent que l’innovation ? N’est-ce pas cette histoire ou cette culture de long terme qui permet l’adaptation « darwinienne » (sine qua non !) des organisations humaines aux défis permanents qu’apporte avec lui l’avenir ?
N’est-ce pas en fonction de cette nécessité d’adaptation que l’on convient déjà généralement que certaines perspectives d’innovations doivent être contrôlées et limitées, compte-tenu des dérèglements qu’elles peuvent provoquer (financières, biologiques, médicales, chimiques, alimentaires, environnementales par exemple) ?
Aujourd’hui, il nous semble que la réflexion générale sur la notion d’innovation doit pour progresser porter sur la définition et les conditions de possibilité d’une culture d’innovation (au niveau d’une entreprise, comme au niveau sociétal), qui soit comme toute culture un ensemble à long terme de valeurs, de mentalités et de capacités adaptatives, à même de favoriser la sélection d’inventions, la mise au point de leur chaîne de création, leur diffusion et leur utilisation en fonction du bien commun.
Car on ne peut s’attendre à maîtriser le jeu des significations implicites d’un concept que si on en a pris conscience.
Olivier Adam Ancien directeur d’entreprise (autoroutes, aéronautique), conseil en transformation et leadership, auteur de « La Softidéologie » (Robert Laffont) sous le pseudonyme de Pierre Barbès en collaboration avec François-Bernard Huyghe