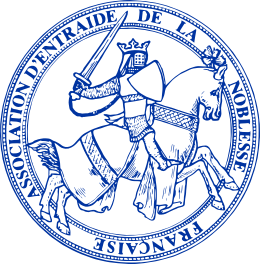News

Famille Chrétienne : "Emmanuel de Valicourt : « Les frères de Louis XVI lui ont terriblement nui »"
Louis XVI ne fit pas seulement face aux événements politiques, mais subit d’incessantes pressions familiales qui entravèrent l’exercice du pouvoir. C’est la thèse développée par Emmanuel de Valicourt dans un livre aussi érudit que haletant. Entretien.

Louis XVI possède une personnalité plus complexe que ne le dit l’historiographie officielle. - AGENCE BULLOZ - RMN-GP
Pourquoi s’intéresser aux parents et aux frères de Louis XVI ?
À tous, apologistes et détracteurs, Louis XVI demeure suspect. Il est l’homme qui ne savait pas être roi, incapable d’endiguer la terreur révolutionnaire; peut-être aussi parce qu’on l’a empêché de l’être. Les relations du roi avec ses parents, avec son grand-père Louis XV, avec ses tantes, avec ses cousins des autres branches Bourbon, et surtout avec ses frères, ont alourdi l’exercice du pouvoir et participé à l’effondrement de l’Ancien Régime. Elles jettent un éclairage nouveau sur la Révolution et la période la précédant. Comprendre les ressorts psychologiques des faits historiques et de leur enchaînement est ce qui m’intéresse. Or, nos psychologies sont souvent familiales. Et la famille occupe une place centrale au XVIIIe siècle. Siècle, par ailleurs, des correspondances pléthoriques et des mémoires. Nombre de mes sources sont connues, mais n’ont pas été étudiées en ce sens, hormis chez Jean de Viguerie et Pierrette Girault de Coursac, parmi les premiers à s’affranchir d’une certaine doxa, pour ouvrir la porte à un pan inexploré de la recherche. J’ai suivi leurs traces.
Emmanuel de Valicourt, docteur en droit et enseignant, est aussi historien autodidacte, passionné par la société française de l’Ancien Régime pré-révolutionnaire. Il est l’auteur de Charles-Alexandre de Calonne, ministre de Louis XVI (éd. Clément Juglar), salué par la critique, puis des Favoris de la reine, et de La Princesse de Lamballe (éd. Tallandier).
Loin des caricatures, curieux et travailleur, Louis XVI n’en fut pas moins un roi empêtré dans d’insolubles contradictions. Quels sont vos sentiments pour lui ?
L’historiographie officielle, notamment celle de la IIIe République a repris les mensonges des pamphlets révolutionnaires, en propageant l’image d’un roi apathique et insensible, ce qui est faux. Louis XVI était timide, solitaire, parfois dépressif et économe de sa parole. Mais aussi affectueux avec ses proches, courageux dans l’adversité et ignorant la peur. Féru de sciences exactes et lecteur infatigable, il fut un travailleur consciencieux. Mes sentiments à son égard sont partagés: homme intelligent, beaucoup plus fin qu’on ne l’a dit, il a une psychologie compliquée et parfois immature – son rejet de son cousin Orléans en est le signe. Sa psychologie renfermée, indissociable de son environnement familial, encore une fois, est un élément clé.
Qui sont les parents de Louis XVI ?
Louis-Ferdinand, son père, est le fils de Louis XV et Marie Leszczynska, seul garçon au milieu d’un cheptel de filles. Veuf à seulement 17 ans, il est remarié dans la foulée de la mort en couches de sa première épouse très aimée, au mépris de sa sensibilité. Mais, contre toute attente, son remariage avec Marie-Joseph de Saxe, fille du roi de Saxe et de Pologne, se révélera heureux. Ils vécurent sans doute la plus belle histoire d’amour de la dynastie des Bourbons, partageant le goût d’une vie simple, axée autour du travail intellectuel, ainsi qu’une piété profonde, flirtant parfois avec une forme de mysticisme. Raillé par les courtisans de Versailles, pour qui l’amour conjugal était le propre du bourgeois, le couple eut quatorze enfants. Seuls six survécurent à la petite enfance : Louis-Joseph-Xavier, titré duc de Bourgogne (1751), Louis-Auguste, duc de Berry, futur Louis XVI (1754), Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence, futur Louis XVIII (1755), Charles-Philippe, comte d’Artois, futur Charles X (1757), Marie-Adélaïde-Clotilde, qui deviendra reine de Sardaigne (1759), enfin Élisabeth-Philippe, qui accompagnera Louis XVI à la prison du Temple (1764)… Louis-Ferdinand fut un père attentionné et adoré de ses enfants. Marie-Joseph était plus froide.
Dans les coulisses de l'Histoire
De nombreux ouvrages portent sur les relations conjugales du roi Louis XVI, mais peu s’intéressent à ses parents, Louis-Ferdinand et Marie-Joseph. Ils sont morts avant de pouvoir accéder au trône. Son frère aîné, le duc de Bourgogne, objet de toutes les attentions, aurait dû régner s’il n’était pas mort prématurément. Quels étaient ses liens avec son impénétrable grand-père, Louis XV, et avec ses cadets, les comtes de Provence et d’Artois ? Que nous disent les relations de cette fratrie, aux personnalités si dissemblables, divisée jusque dans la tourmente révolutionnaire? Si les Bourbons ont le sentiment d’une destinée collective, c’est aussi collectivement qu’ils participèrent à la ruine de la monarchie. Un livre à la plume acérée sur un pan méconnu de l’histoire française.
Pouvez-vous aussi nous brosser les personnalités de Louis XVI et ses frères ?
Le duc de la Vauguyon, gouverneur des enfants de France, surnomma les quatre petits princes « les 4 F»: le fin, le faible, le fourbe et le fol. Très différent de son aîné et de son cadet (deux esprits brillants mais dominateurs), le futur Louis XVI est un enfant solitaire, triste et silencieux, à la sensibilité très forte, assez simple, d’une droiture naturelle. Plusieurs épisodes révèlent la fragilité de son affectivité. Très tôt, le fossé se creuse entre les frères. Des relations de rivalité se mettent en place. Bourgogne, l’aîné, se sent supérieur. Berry est complexé, Provence est calculateur et dissimulateur. Imprévisible, Artois gardera toujours quelque chose de l’enfant mal élevé et égoïste.
Excellent père, Louis-Ferdinand n’en aurait pas moins commis des erreurs éducatives, qui se révéleront fatales sur Louis XVI. Quelles furent-elles ?
Ayant très tôt compris qu’il ne régnerait pas, Louis XV prenant soin de l’écarter de la vie politique, Louis-Ferdinand se concentre sur l’éducation de ses fils, leur inculquant le sens du devoir et des responsabilités. « Il faut que j’en fasse des hommes pour qu’un jour ils deviennent des princes », écrit-il. Il leur répète qu’un bon roi est un roi bon. Erreur fatale. Ce précepte paternel aura un prolongement catastrophique sur la psychologie de Louis XVI. Car un bon roi est avant tout un roi qui gouverne! Il leur enseigne aussi que l’autorité royale ne peut se partager, reposant sur la tête du roi seul, parce que d’origine divine. Ce qui créera un hiatus dans la pensée politique de Louis XVI, écartelé entre sa fidélité à l’héritage dynastique et à la mémoire paternelle, son rejet du système de cour louis-quatorzien et son attrait pour les idées des Lumières. Mais le principal reproche que l’on puisse faire à Louis-Ferdinand est d’avoir négligé la formation pratique en matière politique et militaire.
Comment Louis XVI fit-il face aux deuils successifs qui jalonnèrent toute sa période de formation ?
Ce qui frappe dans l’enfance et l’adolescence du petit Berry, c’est en effet une succession de deuils. Son frère aîné, à qui il dut tenir compagnie durant ses sept mois d’agonie, endossant le costume de souffre-douleur sans broncher, meurt alors qu’il n’a que 7 ans. Terriblement amaigri, entré dans une sorte de détachement neurasthénique et misanthrope, Louis-Ferdinand contracte « un refroidissement » – en fait, la tuberculose. Il meurt à 36 ans. Puis c’est au tour de Marie-Joseph. Après avoir elle-même sombré dans la dépression, ruminant des idées morbides, et ayant conservé les vêtements de son mari comme des reliques, elle lui succède dans la tombe quatorze mois plus tard. Marie Leszczynska meurt de chagrin elle aussi. On imagine le traumatisme sur un enfant comme Louis XVI. Ces deuils le laissent seul avec le vieux roi louvoyant et sceptique. Même si les deux finiront par s’entendre assez bien, Louis XV appréciant sa franchise et sa droiture, l’isolement moral de Louis XVI ira croissant. Sans amis ni favoris, celui-ci est mis d’autant plus en relief par ses relations avec ses frères.
Quel rôle jouèrent ses frères durant le règne de Louis XVI ?
Dès le début du règne, les frères du roi s’imposent à lui, le provoquent, voire remettent en cause sa légitimité, bref lui nuisent. Ils obtiennent de lui l’autorisation de l’appeler «mon frère » plutôt que « sire », sapant toujours davantage son autorité et son image royale. Terriblement jaloux, le comte de Provence passe son temps à intriguer pour se donner une sphère d’influence. Il fait tomber Turgot, puis Necker et devient ensuite le principal artisan de la chute de Calonne, faisant ainsi échouer son projet de réforme fiscale, présenté au roi en août 1786. Mettant un terme aux privilèges, ce projet visait à instaurer l’égalité devant l’impôt. Calonne fut le seul à proposer, dans cette période, une réforme d’ampleur et courageuse dont l’objectif était de sauver le trône face aux périls. Artois, quant à lui, enchaîna les scandales, les dettes et les maîtresses, entraînant derrière lui toute une jeunesse turbulente de la Cour.
Quelle fut également leur influence sur Marie-Antoinette, dont l’image déplorable nuisit tant au régime ?
Avant même son arrivée à Versailles, Marie-Antoinette est l’objet de cabales. Poussé par Madame Adélaïde, fille de Louis XV, le comte de Provence multiplie les campagnes de dénigrement contre l’épouse de Louis XVI et alimente les railleries sur «la faillite de l’alcôve», faisant jaser la Cour pendant sept ans. Il noyaute l’entourage de la reine et la flatte dans ses plus petits côtés. Dans le but de ternir son image. Artois, lui, se sert de la reine comme d’une caution morale. Il l’entraîne dans ses sorties nocturnes parisiennes, l’initie aux jeux d’argent, aux courses de chevaux, aux paris fous. La poussant à s’affranchir de ses devoirs, il instille dans son esprit qu’elle peut tout se permettre. Le mariage des comtes de Provence et d’Artois n’arrangea rien. Ils épousèrent les princesses Marie-Joséphine et Marie-Thérèse de Savoie, filles du roi Victor-Amédée III de Sardaigne. Les deux sœurs, très imbues de leur rang, assez laides et insipides, se ligueront contre Marie-Antoinette, le royaume de Piémont-Sardaigne étant en mauvais terme avec l’Autriche. La naissance du Dauphin, le 22 octobre 1781, après onze ans de mariage et trois ans après Madame Royale ravivera un peu plus la jalousie des frères.
Comment agirent les frères depuis leur exil ?
Honni par l’opinion, Artois, dont la tête fut mise à prix par les révolutionnaires, s’enfuit avec trente louis en poche au lendemain de la prise de la Bastille, en juillet 1789, au cours de cet «été de la grande peur» où, à travers tout le Royaume, on pilla, on attaqua, on brûla et on assassina. Deux ans plus tard, les deux frères coururent ensemble les chancelleries d’Europe pour monter une opération militaire et tenter de libérer le royaume des factieux. Mais laissèrent le souverain seul face à l’adversité. En janvier 1793, Provence écrivit cette lettre terrible à Artois : « C’en est fait, mon frère, le coup est porté. […] Je tiens dans mes mains la nouvelle de la mort officielle de Louis XVI. […] On m’apprend aussi que son fils s’en va mourir. […] Vous n’oublierez pas de quelle utilité pour l’État va devenir leur mort ; que cette idée vous console. Et pensez que votre fils est après moi, l’espoir et l’héritier de la monarchie. » Le cynisme est total. La désunion et la lutte fratricide des derniers rois de France furent une aubaine pour les édiles révolutionnaires.
Lire l'article sur www.famillechretienne.fr
Par Diane Gautret
Publié le 15 février 2025