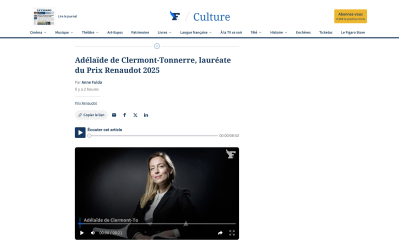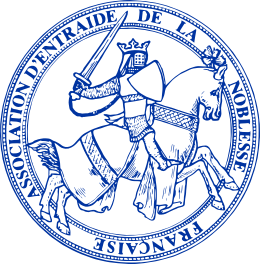News

Le Figaro : "«Pierre Boulez m’a accusée de révisionnisme»: enquête sur les liens entre le pouvoir et les musiciens"
21 mars 2025
Revue de presse
Vue 945 fois
ENTRETIEN - Dans Les Musiciens et le Pouvoir en France. De Lully à Boulez, la musicologue Maryvonne de Saint-Pulgent explique comment les monarques puis les chefs d’État ont utilisé certains...
Il faut être connecté pour lire la suite